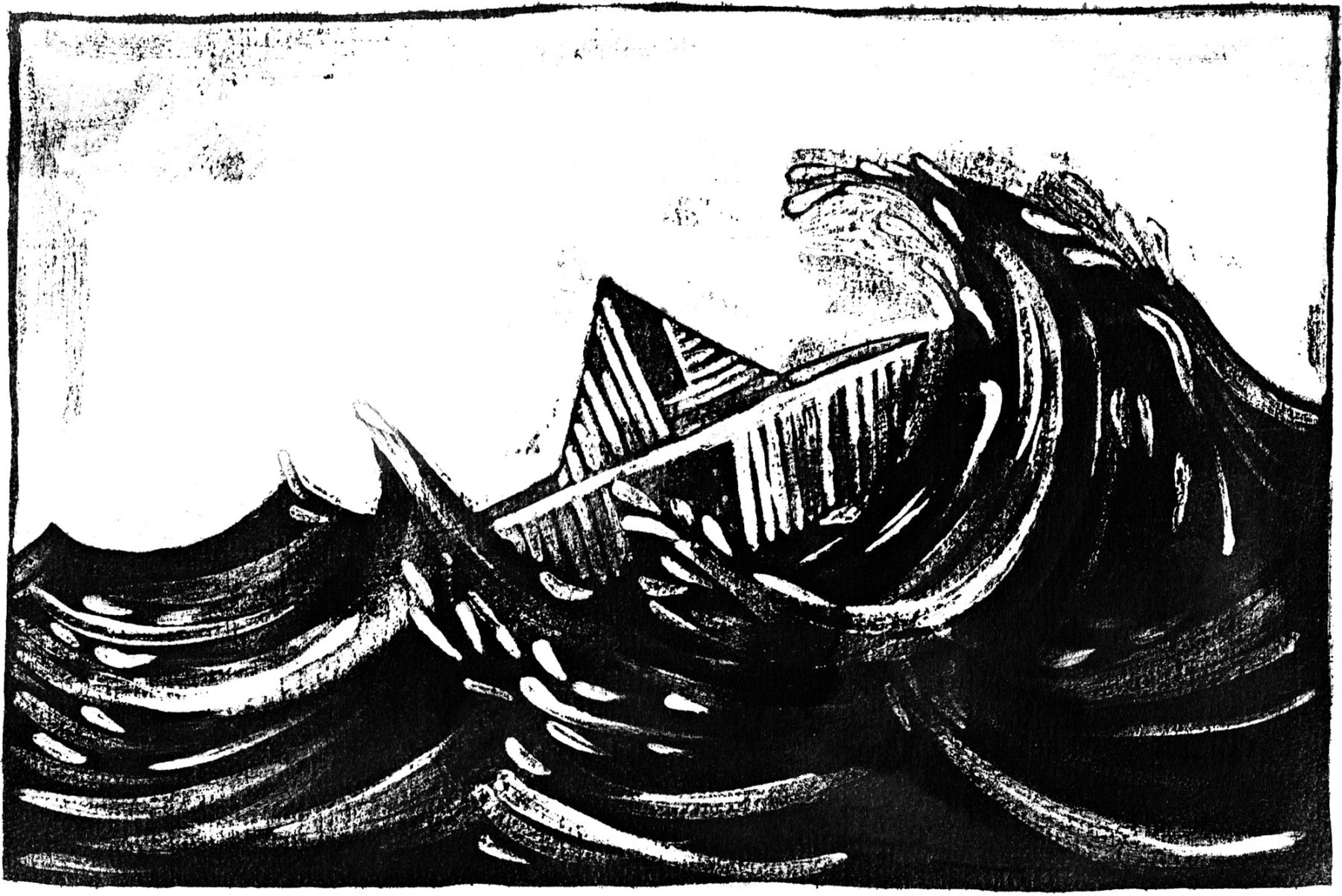Comment, quand on est journaliste, déterminer la frontière entre ce qui pourrait être misérabiliste et ce qui, à travers l’émotion, peut être une première accroche pour porter un discours ?
Contrairement à un documentariste qui peut être beaucoup plus dans la dénonciation, le journaliste ne peut pas défendre un point de vue mais doit donner à voir, être neutre. Ça se construit, par la réflexion, en parlant avec les spécialistes du domaine traité, en connaissant les écueils. Cela permet de limiter l’inconsistance. Il faut arriver en ayant en tête que l’émotion peut-être un vecteur mais que l’émotion peut aussi faire basculer dans le misérabilisme. En fait, il faut être plutôt Zola, être plutôt naturaliste, que journal à sensation.
Mais par exemple, avec l’image, les photos chocs, à quel moment on entre dans le sensationnalisme ? Est-ce qu’il faut par exemple montrer le cadavre d’un enfant échoué sur une plage, ou les migrants qui chutent de leur embarcation pour évoquer des politiques migratoires ?
Et s’il fallait simplement les montrer, parce que ça existe ? Bien sûr qu’il y a une part de reconstruction, qu’il y a tout ce qui se passe en dehors du cadre de la photo, ou quand on filme en télé, il y a tout ce qui se passe à l’entour qui n’est pas forcément transmis. Mais ce ne sont pas non plus des mises en scènes. Les choses sont, donc on les montre. L’image devient vectrice d’une situation beaucoup plus globale. Cela fait partie de faits qu’il faut décortiquer, additionner, voir, à côté des chiffres. Les larmes peuvent aider à décrypter une situation, débloquer l’envie de comprendre, être un vecteur de connaissance. Mais aujourd’hui, on ouvre à fond les robinets à émotion : elle est utilisée partout et tout le temps. Dans ce bain de larmes et d’émotions, cela va peut-être être une dose supplémentaire d’émotions qui va faire la différence. Et c’est peut-être là qu’on commence à basculer dans l’excès. Dans la surenchère : puisque l’émotion est un médium reconnu, qu’on sait que ça marche, il en faut de plus en plus. Dans certaines rédactions, les thèmes des reportages comptent parfois moins dans le choix de faire un reportage que la charge émotionnelle qu’il va posséder.
Mais il n’empêche que les émotions doivent être utilisées, d’abord parce que les gens les vivent. La colère, les larmes dans l’interview, on les ressent. Alors pourquoi les gommer ? Le tout c’est de ne pas pousser pour les faire pleurer. Et ne retenir que ça. Ne pas être putassier. Car il y a une façon de faire dans les interviews, de se confondre, perdre son rôle et se laisser submerger par le récit en poussant les gens dans leur retranchement. D’aller au-delà d’une empathie « je rentre dans votre situation et j’essaye de comprendre » et n’être plus que le réceptacle du ressenti. D’oublier les faits pour ne garder que l’émotion et les pleurs.
Dans les portraits particulièrement, la limite est toujours ténue, puisqu’on met en évidence une seule personne. Mais ce n’est pas parce que l’on rencontre des gens qu’on va faire corps dans le sujet que l’on fait après, à partir de leur situation. Il faut raison garder, ne pas oublier le pouvoir que l’on a. Car nous reconstruisons les discours. Il n’y a pas de mise en scène au sens mystification mais y a un cadrage. On reconstruit la réalité puisqu’on condense une situation complexe en 1’15 en radio ou en une photo. C’est donc difficile de faire passer les nuances et la complexité d’une situation comme par exemple celle de la pauvreté dans un reportage. C’est aussi le temps qui fait que l’émotion est un outil plus facile. Quand on n’a pas beaucoup le temps, c’est par l’émotion et la voix émotive du témoin que les choses passent. Cela peut aider à mettre en condition les spectateurs pour recevoir un message mais il faut se souvenir que c’est nous qui reconstruisons le discours.
On sait que voir quelqu’un pleurer à l’écran peut susciter l’empathie ou l’effet miroir, est-ce qu’il n’y a pas aussi l’effet inverse, des gens qui se sentiraient manipulés ?
Oui, utiliser cet effet miroir peut jouer comme un effet repoussoir. Par exemple, toutes les souffrances montrées dans les Antilles suite aux ouragans ont être ressenties comme un trop plein, « on en voit trop » et « toujours les même » qui se reflètent dans de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça. On a eu cet effet de matraquage parce que l’actualité s’entend par le sujet du jour. Sur les situations de difficultés, pour rester pertinent et informant, il ne faut pas « feuilletonner ». Et pas tout le temps faire le sujet sur le même canevas. Mais c’est difficile de se renouveler, parce que c’est une grammaire. C’est d’ailleurs pourquoi je pense que le journalisme devrait s’entendre encore plus avec le théâtre, qui traite de plus en plus d’exclusion ou de pauvreté et possède un temps de recul sur le fonctionnement de la société. Je trouve ça pas mal que les journalistes se nourrissent des méthodes d’investigation et de questionnement de l’artiste pour essayer de mettre du temps lent dans ce qu’on lui demande de faire vite, puisque c’est aussi une question de rapport au temps. Il faut en tout cas questionner tout le temps sa pratique pour ne pas renforcer les lieux communs des spectateurs ou préserver les ségrégations. Il ne faudrait pas que l’on en arrive à conforter les stéréotypes dans la tête des gens.
Vous disiez dans une de vos interventions, qu’ « on ne parle pas de la pauvreté dans les médias, on parle des pauvres ». Est-ce que ce principe se décline dans d’autres secteurs, on ne parle pas de la migration, mais de migrants, on ne parle pas de l’occupation israélienne mais de familles palestiniennes ?
Pourquoi fait-on cela ? Parce que c’est l’humain. Depuis 1945, la figure de la victime a pris beaucoup de place. On incarne un sujet par l’expérience de quelqu’un (on emploi même le mot « incarnation »). C’est à la fois réducteur et à la fois intéressant. Mais si on donne du corps, si on donne de la chair, le squelette doit rester intellectuel. C’est pourquoi on parlera plus de pauvres que de la pauvreté mais tout en connaissant les mécanismes sociaux en jeu, en consultant spécialistes et études sur la pauvreté. On ne doit pas uniquement réaliser une addition d’expériences mais bien essayer de digérer les études, les chiffres pour parler de la pauvreté à partir de l’expérience de ceux qui la vivent, presque à la manière d’un sociologue. Parler de leur situation, cela veut dire : voilà ils sont pauvres, ils sont migrants. C’est vrai qu’on fait souvent ça puisque la nécessité dans l’écriture est de partir de l’expérience des gens, mais ça a quand même changé : on essaye de plus en plus de présenter plusieurs points de vue, de faire des portraits de plusieurs personnes, que ce soit plus global.
À côté de ces images bouleversantes, il y aussi d’autres ressorts que l’image d’injustice criante qui peuvent mettre les larmes aux yeux : celles de manifestations de solidarité, de dignité retrouvée…
Oui, c’est la belle histoire, le happy end, l’investissement… Ça aussi, ça fait sortir les larmes. Plutôt à partir d’un certain âge…
C’est-à-dire, plus la personne est âgée, plus elle serait touchée ?
Le langage de l’émotion est un langage qui marche sur les gens qui ont l’habitude de la télé. Je me demande si ça marche encore sur les jeunes qui la regardent de moins en moins… Ça me rappelle un reportage que j’avais fait, je suivais une école qui allait visiter Auschwitz guidée par Paul Sobol qui en est l’un des rescapés. Il utilisait son histoire, nourrie d’autres récits de la Shoah, pour témoigner de ce qu’il s’est passé. Certes, il arrivait à toucher les étudiants, en les amenant sur les lieux où ça s’était déroulé avec lui, un rescapé qui raconte les évènements qu’il a lui-même vécus, qu’il incarne. Il le raconte assez froidement d’ailleurs, c’est ciselé, c’est naturaliste, ça tire des larmes, parce que ça parle de l’arbitraire, de la solution finale, de l’industrialisation de la mise à mort. Mais là ou cela ne marchait pas, c’est le passage aux préoccupations de lutte contre le fascisme et les extrêmes droite aujourd’hui. Les larmes étaient partagées pour ce qu’elles étaient. Les jeunes pleuraient réellement sur un moment de l’Histoire mais n’arrivaient pas à s’inscrire dans une perception historique et politique. C’est toute la question : est-ce que le témoignage aide à faire comprendre une problématique ? Apparemment, les émotions et les larmes n’aident pas à faire de l’Histoire ou à politiser.
L’émotion n’aide donc pas forcément l’analyse critique…
On ne peut évidemment pas comprendre le monde que par les émotions. S’il y a une visée d’analyse critique au bout du compte, il faut qu’il y ait autre chose à côté. Un discours historique, nuancé, une contextualisation. Car à force de plonger les gens continuellement dans les larmes, on va finir par aboutir à la « société gnan gnan » comme disait Claude Javeau : on devient larmoyant, on s’apitoie et puis, so what ? Les gens pleurent tous en communion devant la télé, devant les images mais ça sert à quoi s’il n’y a pas une mobilisation ? Est-ce que ça fait prendre conscience de quelque chose ? Est-ce que ça donne envie d’analyser le monde ou bien est-ce que ça renforce le « tous pourris » ou un sentiment d’impuissance dans la tête des gens ?