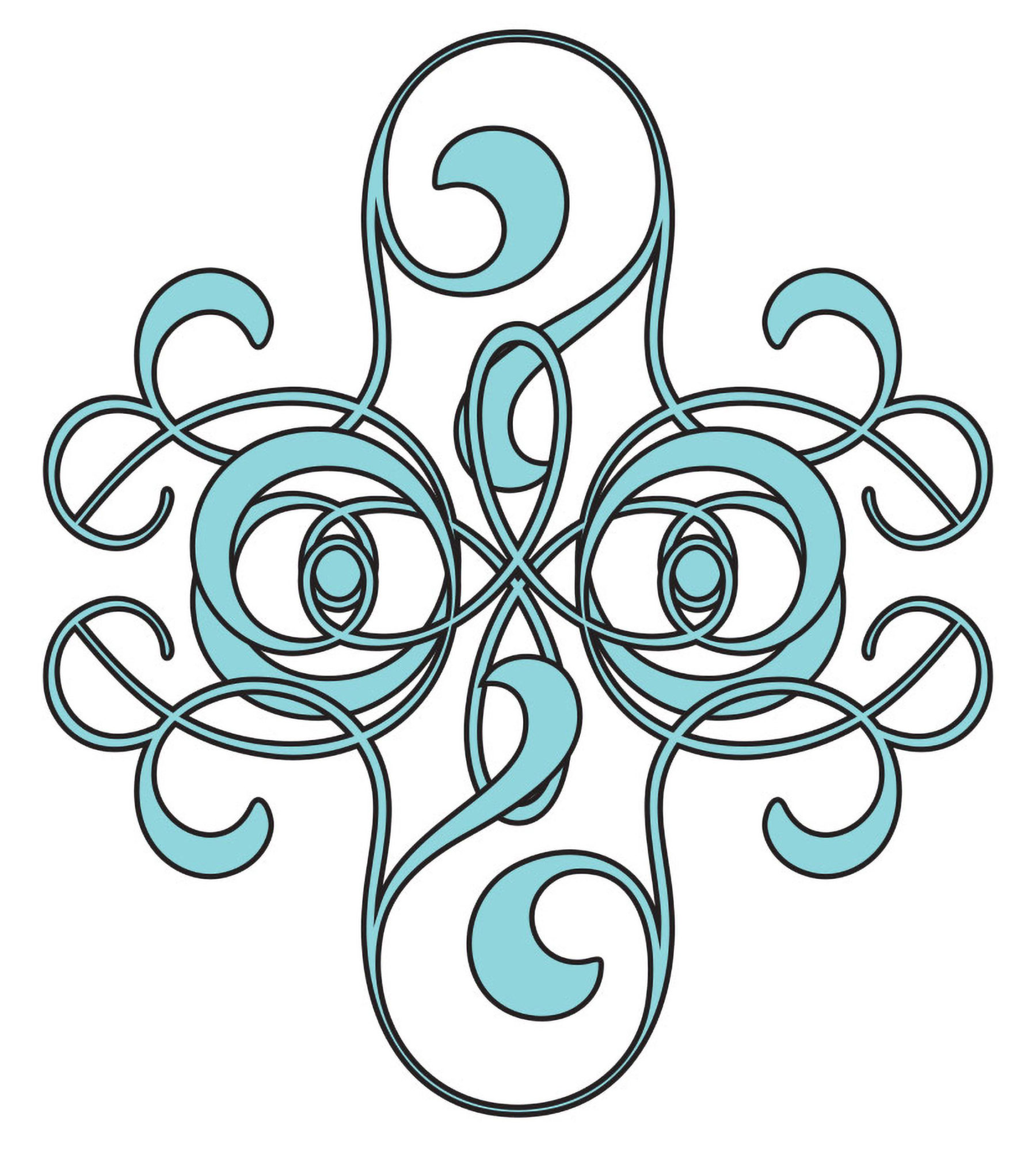Le débat sur la compétitivité est récurrent. Si pas obsessionnel. Le refrain, en Belgique particulièrement, est connu : le coût du travail expliquerait la vulnérabilité de « nos » entreprises dans le commerce européen et mondial, le recul des parts de marché et le chômage qui en résulte. En conséquence, les contraintes de la globalisation et les règles européennes de la gouvernance économique imposent l’évidence : toutes les composantes de la formation des salaires (barèmes salariaux, salaire minimum, cotisations sociales, règles et indemnités de licenciement, indemnités de chômage ou de pension…) doivent être subordonnées, désormais, à des objectifs de compétitivité qui imposent de « contenir » les coûts salariaux.
Moins qu’un débat, plus qu’un discours, on a affaire à un chant choral… Récriminations ou lamentos du banc patronal. Philippiques des estafettes politiques de la guerre salariale – multiples régiments confondus – pour les parts de marché. Systématique des titres de presse et des angles d’information épousant sans sourciller – à quelques signatures près, comme celle de Dominique Berns dans le Soir – les recommandations d’inspiration libérale de la Commission européenne, du FMI ou de l’OCDE en matière de « réformes structurelles » à mener sur le marché de l’emploi (régimes de fiscalité et des pensions compris).
Comment expliquer le consensus quasi général, en dépit du caractère absurde et stérile de cette course sans fin aux gains de compétitivité de tous contre tous ?
Les baisses des uns neutralisent celles, antérieures, des autres, auxquelles elles répondent, et les avantages compétitifs visés sont annulés avant même qu’ils n’aient pu être réalisés. Par définition, la compétitivité étant un concept relatif, les entreprises ne peuvent pas être compétitives en soi. Et, à l’échelle du globe ou d’un espace comme la zone euro au sein duquel s’effectue l’essentiel des échanges commerciaux des pays-membres, les économies nationales ne peuvent pas en même temps être toutes compétitives par rapport à toutes les autres. Les marges des uns se forgent nécessairement au détriment des performances des autres.
Par ailleurs, il n’existe aucun seuil inférieur à une cible de compétitivité. Ce qui fait dire à Paul Jorion que parler de « réformes structurelles de compétitivité » de façon générale ou absolue revient, sans que cela soit dit, à vouloir aligner les salaires français, belges, italiens ou grecs sur « le salaire de subsistance du travailleur le plus misérable de la planète » qui joue ainsi le rôle d’un référent « attracteur » pour l’ensemble des salaires du monde (Le Monde, 14 mai 2013).
Dans ses conférences, l’économiste et anthropologue a d’ailleurs pris l’habitude de traduire l’expression « réformes structurelles de compétitivité » par « alignement sur les salaires du Bangladesh » : une formule qui présente l’avantage d’être comprise plus aisément par ses auditeurs.
L’illusion d’une cause nationale
L’image permet de mieux saisir la profonde mystification à partir de laquelle opère le discours compétitif orienté vers le (toujours) moins-disant salarial. Ce qui est visé, ce sont les salaires, non plus tant comme variables d’ajustement à la concurrence étrangère, mais comme leviers de « dévaluation sociale compétitive » : substitut de l’arme désormais manquante de la dévaluation monétaire dans la guerre commerciale.
La conséquence, ou l’objectif, selon le point de vue adopté, c’est un mouvement structurel de déflation salariale, d’un côté, de hausse, inédite à ce niveau depuis les années 1930, de la part du capital dans la richesse produite, de l’autre. Avec, en final, une recomposition extrêmement polarisée des inégalités de revenus.
On le sait, ou on devrait le savoir. Pourtant, ici comme ailleurs, le chœur des « marges de compétitivité à restaurer » n’accorde à l’enjeu du partage capital/travail de la richesse produite qu’une attention toute relative. L’information sera, certes, régulièrement donnée, quoique de manière fragmentée ; mais la question (au sens politique) ne sera pas posée.
La problématique est, à vrai dire, politiquement et éditorialement plus conflictuelle ou moins fédératrice que ne l’est le thème de la compétitivité de l’économie nationale en péril…
Celui-ci rallie d’autant plus facilement à lui l’attention et une bonne partie de l’opinion, y compris dans les rangs des salariés, qu’il véhicule l’idée d’un intérêt ou d’un combat commun contre les « concurrents étrangers » : tous dans le même bateau… se doivent de ramer ensemble sur la mer sans pitié de la compétition mondiale, si on veut préserver les parts de marché et l’emploi au pays.
Le défi compétitif national et les sacrifices qu’il exige sont plus faciles à faire passer dans des esprits mobilisés de la sorte, note l’économiste Réginald Savage, invité en 2012 du réseau Éconosphères, que « celui d’un alignement sur les exigences internationales accrues de rentabilité et de rémunération du capital ». Lequel, en pratique, s’est imposé, au niveau mondial et européen, à la faveur de la libéralisation complète des mouvements de capitaux, du commerce mondial et, donc, de « la mise en concurrence internationale des espaces salariaux, sociaux et fiscaux nationaux ».
De ce fait, sous couvert de modernisation, de réformes structurelles ou de choc compétitif, la plupart des constructions et des mécanismes de l’État social ont été pris pour cibles et continuent de l’être : la stabilité et les droits attachés au statut de salarié, la négociation sociale centralisée, porteuse de solidarités et de moindres inégalités entre travailleurs d’entreprises et de secteurs différents, les protections sociales, l’indexation automatique en Belgique…
Une guerre totale et inégale
C’est qu’à l’instar des coupes dans les budgets pour réduire les déficits publics, les coupes dans les salaires, dans les prestations sociales et dans les droits des salariés pour stimuler la compétitivité doivent créer, dit-on, les conditions d’une croissance à long terme, elle-même garante de création d’emplois.
Or, c’est désormais démontré et admis jusque dans les cercles de décision au plus haut niveau, les premières ont davantage détérioré qu’ils n’ont redressé les comptes publics, particulièrement ceux des pays bénéficiaires des plans « d’aide » européens. Quant aux secondes, que de nombreuses voix appellent à intensifier, de façon compensatoire, pour faire repartir l’économie à partir d’un électrochoc de compétitivité, elles sont promises à la même impasse. Plusieurs raisons à cela.
Du fait d’abord qu’elles s’inscrivent dans une guerre salariale, sociale et fiscale à la fois totale et inégale, autodestructrice, à terme, pour les économies et les populations qui y sont engagées. La preuve par le bilan économique et social de la Grèce, du Portugal et de l’Irlande.
Ensuite, parce que les gains de compétitivité obtenus par la modération salariale ne se soldent pas automatiquement, comme le veut la théorie, par une baisse des prix ou par une hausse des investissements productifs internes, de nature, toutes deux, à renforcer la position compétitive sur les marchés : dans les faits, nombre d’entreprises, a fortiori dans une économie européenne anémique, choisissent soit de rembourser leurs dettes, soit de rémunérer davantage leurs actionnaires. Dans l’un ou/et l’autre cas, on assiste à un transfert des gains productifs vers la sphère financière.
« Le coût usurier de la ponction actionnariale »
De manière générale, analyse Réginald Savage c’est bien là ce qui caractérise « le régime de croissance à dominante financière et de basse pression salariale » dans lequel nous vivons depuis une trentaine d’années : les gains de compétitivité dégagés par une gestion rigoriste de la main‑d’œuvre et de ses coûts nourrissent des logiques d’accumulation du capital financier plutôt que du capital productif. Soit directement, par le biais des surplus engrangés de la valeur actionnariale au détriment des salaires, soit indirectement, par le recours des ménages au crédit à bon marché venu se substituer aux hausses avortées des revenus salariaux.
En Belgique, la part des richesses produites versées au capital était d’un peu moins de 59 % du PIB au milieu des années 1980 ; elle est de 65 % en 2011, après avoir frôlé les 70 % avant la crise financière de 2008. Et la tendance baissière de part salariale atteint au bas mot 6 à 8 % de PIB depuis 1970 et 13 % depuis 1980. Cet effet de ciseau recouvre des sommes astronomiques qui auraient dû revenir aux salariés, et donc aussi à l’État et à la sécurité sociale ; au lieu de quoi, elles ont été déversées sur les marchés financiers. Les 750.000 milliards de dollars, soit plus de dix fois le PIB mondial, qui circulent chaque année sur les marchés financiers sont le résultat de ce retournement et des opérations de spéculation opérées à partir de là.
Face à une torsion de la richesse d’une telle ampleur, les réponses redistributives classiques de l’État social ne peuvent être qu’inopérantes. Et toutes les danses de la pluie effectuées au pied des mots-totems de la gouvernance économique n’y feront pas davantage. La seule véritable issue non à « la crise », autre terme fétiche, mais à la logique de prédation financière à l’œuvre, c’est la revalorisation concertée de la part de salaires dans le partage des revenus primaires. Elle seule est en mesure de réduire à la source le « coût usurier de la ponction actionnariale » sur les économies, les trésors publics et le bien-être des populations.