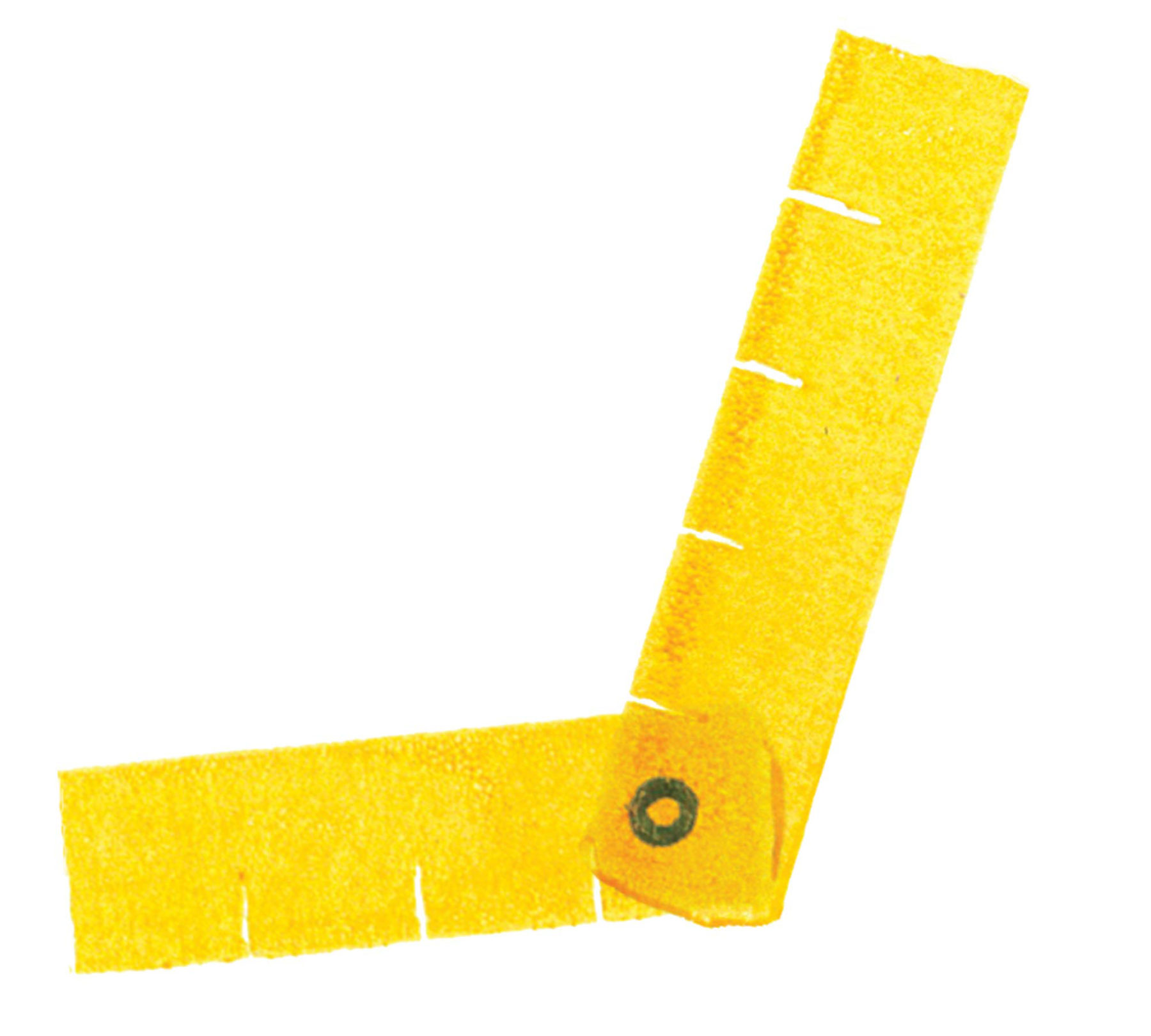Est-ce qu’on entre dans une espèce d’idolâtrie du nombre ? Le quantitatif a‑t-il gagné sur la qualitatif ?
Le passage du qualitatif au quantitatif est un passage de la singularité à la prévisibilité. Ce triomphe du nombre a été regardé par une série de penseurs du 20e siècle comme la victoire d’une abstraction, d’une culture superposée au réel, qui nous faisait perdre de vue ce que Husserl appelait le « monde de la vie » ou Bergson la visée de « l’intuition ». La qualité peut effectivement être le support d’un rapport privilégié, d’une relation où l’on s’intéresse à la part incalculable et intrinsèquement singulière du réel. Entre la quantité et la qualité, il y a toute la différence, mais aussi la relation, entre l’âge d’une personne et la jeunesse réelle de son esprit.
Il ne faut toutefois pas oublier que le singulier peut aussi être divinisé. Si l’on connaît actuellement une idolâtrie du nombre, il faut rappeler que les régimes précédents fonctionnaient plutôt par idolâtrie de la qualité, ce qui n’est pas forcément mieux. Ainsi, les arguments invoqués pour légitimer un pouvoir symbolique, quel qu’il soit, qui n’a pas à se justifier sont des arguments par la qualité. Le « Chef » l’est en vertu de ses qualités de « Force » ou d’ « Autorité », et les majuscules, ici, trahissent la part parfois irrationnelle des régimes qualitatifs. Par ailleurs, les contestations démocratiques de ce pouvoir, sont quant à eux des arguments que l’on appelle ad quantitatem, par la quantité, ou ad numerum, par le nombre : c’est la voix du plus grand nombre qui prime. La démocratie est donc aussi une quanticratie, et tout triomphe du nombre est aussi un triomphe de la démocratie. Les choses sont donc très paradoxales et il faut, me semble-t-il, le garder en tête, sous peine de tomber dans une sorte de romantisme de la qualité.
Qu’est-ce que l’on fait de la part d’incalculable dans notre société marquée par une culture du nombre ?
Le problème est que toute culture du nombre suppose un comparatisme. Si l’on chiffre, c’est pour comparer, pour ordonner, parfois pour noter ou calculer des moyennes et, plus généralement pour inscrire un évènement dans un ensemble d’autres évènements. Le danger réside donc plus dans le comparatisme universel que le nombre en lui-même. On est actuellement dans une société de la comparaison générale. Et toute comparaison suppose que l’on s’accorde sur ce que l’on compare et donc que l’on réduise les phénomènes à leur part chiffrable. On calcule le nombre d’amis, de « likes », l’audience d’une émission, les performances d’une entreprise, le poids d’un individu, son quotient intellectuel et le nombre de calories dont il a besoin. Mais quid de ce qui fait la saveur et la réalité du rapport au monde ? Si la culture du nombre peut être violente, c’est parce qu’elle fait oublier tout ce qu’on ne peut pas chiffrer. Il y a aussi là un enjeu politique, comme on le voit dans la culture de l’évaluation au travail. On peut, sur base de toute une série de paramètres, évaluer des travailleurs en assignant une note à chacune de leurs actions. Mais qui aura définit l’échelle, les aspects à prendre en compte et ceux qui ne sont pas pertinents ? Ce peut être violent car tout l’aspect plus subtil du rapport au monde, au travail, et à tout ce que, humainement, on y investit, n’est pas forcément vu par les chiffres.
Le robot, le supercalculateur participe à cette prégnance du nombre dans nos vies. Dans votre livre ChatBot le Robot, vous faites le récit d’un robot à qui on apprend la philosophie et qui passe un examen pour valider ses qualités de philosophe devant un jury d’humains. Comment vous est venue cette idée ?
Cela faisait longtemps que j’avais envie d’écrire sur la question de l’intelligence artificielle. Je me suis dit que la meilleure façon de le faire était d’être le plus paradoxal possible et d’organiser la rencontre entre deux réalités diamétralement opposées : l’intelligence artificielle et l’intuition philosophique. Ce que permet la fiction. En créant un être, le ChatBot, qui réunirait ces deux points de vue, il devenait possible de poser la question réflexivement, et d’échapper au fantasme typique énoncé comme « j’ai peur de l’intelligence artificielle ». Car l’existence de nouvelles intelligences va obliger la philosophie à se redéfinir et à chercher à nouer de nouvelles relations avec la machine, moins phobiques, moins utilitaristes, mais plus « technopolitiques », pour employer un néologisme.
Chatbot finit par choisir de se mettre au service de la philosophie qui n’a pas de valeur utilitaire. Mais dans nos sociétés, est-ce que ces intelligences artificielles ne sont pas développés avant tout par et pour le secteur financier ?
Tout à fait. C’est à cela que beaucoup d’intelligences artificielles perfectionnées servent : elles sont développées pour les marchés et le trading à haute fréquence. La vitesse de calcul ou la technologie de transmission d’informations par fibres optiques a été motivée par la nécessité d’être le premier à conclure une opération financière sur un marché. Les robots sont de tous nouveaux acteurs qui changent les règles et rendent obsolètes les pratiques humaines. Ils faussent tout, d’un certain point de vue. Dans ChatBot, je fais une proposition : comme il y a des joueurs compulsifs qui doivent être interdits de casino, les supercalculateurs devraient être interdits de marchés. Ce ne sont pas des simples aides au placement ou au trading, mais bel et bien des traders non-humains, qui ont leur marge de décision. On doit donc édicter des règles qui ne sont pas les mêmes que pour les humains. Et c’est peut-être ce que la fiction, en se servant du paradoxe, permet d’exprimer.
Dans Chatbot est-ce qu’il y a aussi l’idée de la place que prennent les technologies. Vous parlez d’une certaine déification comme on parlait d’une certaine idolâtrie du nombre ? Est-ce qu’on n’idolâtre pas non plus les machines et l’intelligence artificielle ?
Complètement, on les fantasme, on les idolâtre, on leur délègue beaucoup trop de nos désirs, on les rend garante de certaines de nos croyances. Le processus de délégation aux machines de nos désirs, de nos manières de travailler est absolument vertigineux. Je pense qu’on est dans une phase de très grande accélération. On le voit en médecine avec des résultats superbes qui sont des résultats qui sont permis par les technosciences — je pense à des opérations du genou a ou du cerveau assistées par ordinateur ou effectuées par des robots qui ont une finesse d’action qu’un chirurgien n’aurait pas. C’est certain que c’est assez prodigieux et que c’est le début avec toujours ce grand risque, cette grande peur, que de voir d’autres domaines encore colonisés par des intelligences artificielles.
Mais ce n’est pas de cela dont j’ai peur. Ce dont j’ai peur, ce sont les pouvoirs que servent ces intelligences artificielles. C’est vraiment cela la question. En tant que telle, je trouve que l’œuvre humaine visant à créer une sorte de réplication de l’intelligence est prodigieuse et fait partie d’un très bon but culturel. Et d’ailleurs on a toujours voulu s’imiter soi-même. Maintenant quels sont les pouvoirs ? Quels sont les pouvoirs — surtout économiques- qui sont derrière ces intelligences artificielles ? Qu’est-ce qu’une robocratie dans le monde du travail ? Les vraies questions sont là.
Quelle question pose la robocratie ?
C’est la question de l’emploi : c’est-à-dire l’obligation de redéfinir la valeur travail et de redéfinir ce qu’est le travail véritablement. En dehors de cela, je trouve beaucoup de robots tout à fait sympathiques. Mais quand les travailleurs perdent leur emploi à cause d’un progrès technoscientifique, qu’ils doivent culpabiliser de perdre leur emploi dans une société qui fait du chômage la pire des hontes, et qu’on ne réinvente pas le travail, alors on est devant un vrai problème.