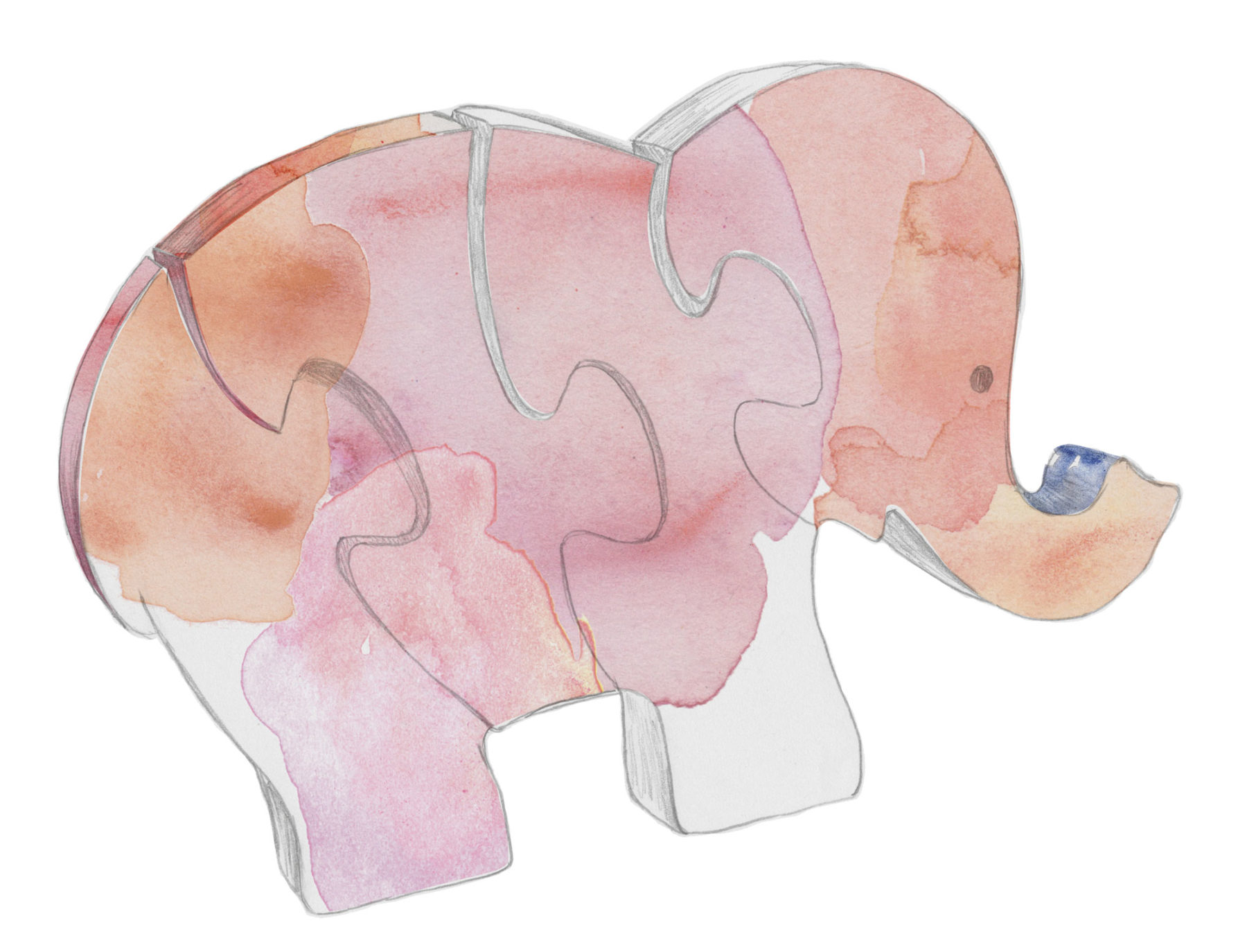Historiquement, il est bon de le rappeler, la lutte du journalisme contre les secrets ou les abus du pouvoir va constituer un levier important de contre-pouvoir. Le journalisme fait figure de « chien de garde » de la démocratie : celui qui aboie pour donner l’alarme. Encore convient-il qu’il ne surinterprète pas son rôle en confondant travail d’enquête et de contrôle, et mission de justicier ou de purificateur éthique… La tentation n’est jamais loin quand on sait à quel point l’évolution des hiérarchies de l’information, ces dernières décennies, survalorise l’activité judiciaire, en particulier l’activité pénale, par rapport à la mise en perspective de celle-ci dans la société, ainsi que par rapport à d’autres enjeux.
Dans ce registre, n’a‑t-on pas vu grandir, dans ce que l’on peut appeler la déferlante médiatique post-Publifin, une exigence explicite de transparence (sur les revenus de l’action représentative), et celle, sous-jacente, d’une pureté ou d’une exemplarité parfaite des responsables politiques ? La posture fait mouche, la plupart du temps, auprès du corps social, qui attend que le politique qui « dérape » soit sanctionné par le pouvoir judiciaire, et, partant, que la Justice lave plus blanc que blanc. Mais, « comme on a tous une part de gris en nous », notait le juge retraité Christian Panier dans la Libre Belgique en 2007, les « citoyens-audiences » cherchent à se réapproprier la part manquante de blanc en eux « à travers les puissants qui ont des ennuis », que leur culpabilité soit démontrée ou non.
LE GRAND BAZAR MÉDIATIQUE
Le sujet de magazine télé « Mon bourgmestre a‑t-il le bras long ?», (re)diffusé début mars sur la RTBF dans la foulée d’une convaincante enquête-illustration sur les ressorts de l’affaire Publifin, est, à cet égard exemplatif. Le propos de son auteur, qui suit les pérégrinations locales de quatre bourgmestres « connus », est d’interroger, d’une part, les stratégies de contournement (bien réel) des règles d’incompatibilité entre fonctions ministérielles et maïorales, d’autre part, les pratiques d’utilisation des leviers « d’influence » qu’offrent aux bourgmestres des situations de cumul de mandats à différents niveaux de pouvoir.
Pour peu que l’on acquiesce à sa pertinence, pareil questionnement, nous semble-t-il, se doit d’être non seulement développé avec cohérence, mais aussi traité de façon effective et probante. Ce que ne fait manifestement pas le reportage : il ne permet en tout cas pas à son public de dépasser le niveau de la conviction intime de l’auteur. Concrètement, le reportage traduit les interrogations de départ en différentes scènes sur différents théâtres d’action ; il travaille de la sorte à une description « phénoménologique » de situations sélectionnées et construites de manière à illustrer les hypothèses de l’auteur, mais non à en démontrer le bienfondé. On est, ici, en présence d’une construction journalistique qui se déploie en dehors de toute construit conceptuel ou argumentatif sous-jacent, le journaliste se positionnant plutôt en « surplomb » éthique. Seul le halo de suspicion permanente de son questionnement, dans lequel baigne le suivi de quatre bourgmestres « tests » ou « témoins », permet de fonder, virtuellement, la thèse du risque de dérive lié au cumul de mandats.
Ce type de production journalistique et l’orientation éditoriale dans laquelle il s’insère sont représentatifs, à nos yeux, du « grand bazar médiatique » à l’œuvre…
Au-delà du véritable lièvre levé dans les terriers de Publifin, on a vu se multiplier les « révélations » d’autres « cas » jugés suspects, à la faveur d’un énième phénomène d’emballement médiatique, immodéré comme le veut le genre… « Quand une tempête médiatique se lève, notait à cet égard, en 2007, l’ex-éditorialiste du Morgen Yves Desmet il n’y a aucune mesure, encore moins de modération, qui vaille. Une tempête médiatique est de 12 beauforts, ou elle n’existe pas. »
L’écrivain mais aussi journaliste Emile Zola le constatait, déjà à son époque, dans un texte peu connu datant de 1889 : « Mon inquiétude unique, devant le journalisme actuel, c’est l’état de surexcitation nerveuse dans lequel il tient la nation (…) [I]l s’agit d’un fait social. Aujourd’hui, remarquez quelle importance démesurée prend le moindre fait. Des centaines de journaux le publient à la fois, le commentent, l’amplifient. Et, pendant une semaine souvent, il n’est pas question d’autre chose : ce sont chaque matin de nouveaux détails, les colonnes s’emplissent, chaque feuille tâche de pousser au tirage en satisfaisant davantage la curiosité de ses lecteurs.»
IL FAUT NOURRIR LA BÊTE
Dans le contexte actuel, pour occuper le terrain Publifin aussi longtemps que les concurrents s’y trouvent, eux aussi, il s’agit de « nourrir la bête » quotidiennement, voire heure par heure sur les supports numériques, selon la logique de l’information en continu. On a vu alors toutes les rédactions se mettre à courir dans tous les sens, un peu comme des poules sans tête, à la recherche de l’une ou l’autre prise post-Publifin, de l’une ou l’autre indemnité publique jugée « trop » élevée, de l’un ou l’autre cas d’incurie dans la gestion de l’argent public. Comme si chacun voulait son trophée…
Dans le grand mixer de l’information, tout a fait farine : d’une secrétaire particulière de Magnette « indûment rémunérée » à la fille avocate de Jean-Claude Marcourt dont on se demande si elle a « vraiment travaillé pour Nethys » ; de la présidente de la commission d’enquête parlementaire « attaquée sur son salaire » au classement purement chiffré des élus wallons en matière de cumul de mandats ; des soupçons de conflits d’intérêts dans le chef de tel conseiller provincial hennuyer aux affaires Publipart et Telenet (impliquant le président N‑VA de la Chambre) en Flandre ; des déclarations polémiques ou maladroites de Louis Michel sur la relativement faible rémunération des parlementaires au débat sur les salaires des CEO d’entreprises publiques ; d’«administrateurs surpayés » (dans le titre) à l’ICDI de Charleroi en raison…d’un « mauvais encodage comptable » (dans le corps du texte) ; de la course politique aux effets d’annonce de réformes de gouvernance aux multiples radioscopies du PS liégeois ; des réflexions sur la démocratie locale dévoyée aux débats sur la démocratie interne des partis ; et, au milieu de tout cela, de façon indistincte, la politisation de l’administration wallonne et la question, ressortie du formol pour l’occasion, de la suppression des provinces…
Une chatte n’y retrouverait pas ses petits ! Et pour cause : il y a là autant de chatons que de poussins, de chiots, de veaux et d’éléphanteaux… Au sein de cette grande ménagerie politico-médiatique, le risque est de voir le discours public verser soit dans l’hystérie de l’amalgame, soit dans l’insignifiance de l’accumulation strictement monétaire. Les exemples ne manquent pas.
DÉMENCE DE L’EXCÈS, PERVERSITÉ DU REJET
Dans l’exercice journalistique de calcul des revenus professionnels des élus, tout se passe comme si telle ou telle valeur monétaire était signifiante en elle-même : « La future présidente de la commission Publifin gagne 7000 euros net par mois. Trop ? », titrait la Libre Belgique, en manchette, le 14 février 2017. Ou, pire, comme si le montant épinglé et le travail presté en échange devenaient, a priori, suspects, dans « le climat général », tant pour la fonction exercée que pour la personne « impliquée » (au sens ambivalent du terme, à la fois active et suspecte). Y a‑t-il eu vérification ou absence de vérification des éléments qui composent l’information ? Autrement dit, quel travail réel, et pas seulement nominal, a‑t-il été effectivement presté ? Avec quelle efficacité en regard de quel objectif ?
Rien de tout cela n’est ni clair, ni explicite. Ce qui pose un réel problème, moins sur le plan déontologique en tant que tel, que sur celui de la responsabilité sociale des journalistes, de l’information et des médias. De fait, à la différence de ce qui a été établi, journalistiquement, dans le dossier Publifin, les divers sujets épinglant des rémunérations « suspectes » ne tranchent pas. Ils donnent aux personnes concernées, le plus souvent, la possibilité de faire valoir leur point de vue, mais en bout de course, ils ne rendent pas de jugement. Volontairement ou non, ils laissent leur audience libre de « se faire son idée ». Et ils laissent, de la sorte, le doute s’installer, dans la mesure où la démarche de vérification n’est pas menée jusqu’au bout : c’est la parole des uns contre les mises en question des autres.
La « démence de l’excès » finit parfois par engendrer « la perversité du rejet », notait le cofondateur de l’hebdomadaire Marianne, Jean-François Kahn, voici quelques années… Qu’il s’agisse, ici, du rejet d’outils ou de modèles d’action publics comme les intercommunales (ou de leur abandon aux mains de la seule gestion et des seuls intérêts privés), de la critique permanente des élus et du monde politique en général sur les réseaux sociaux, ou de « l’oubli » de tout ce qui a évolué et progressé en Wallonie depuis une vingtaine d’années, en ce compris la règlementation, même imparfaite, de la démocratie locale.
UN PRÉSUPPOSÉ TOXIQUE
Le rejet consécutif à l’excès, à la saturation, est aussi un phénomène fréquent qui touche le monde des médias frappé d’infobésité, mais aussi vecteur d’une anxiété liée au trop plein, à l’incompréhension aussi. « Je pense que c’est le problème que l’on a, admet Laurent Mathieu, présentateur des JT RTBF du week-end. Il y a tellement d’informations que les gens ne comprennent pas toujours ce que l’on veut dire. » Quel que soit le baromètre retenu, on constate, en matière de rejet, que la presse et les journalistes font partie des institutions sociétales largement discréditées aux yeux de l’opinion publique.
Plusieurs arguments servent d’alibis, largement autoréférentiels, à un tel emballement collectif. Tantôt on pointera « le climat actuel de suspicion autour des intercommunales », comme pour justifier d’autres formes de suspicion. Dans la foulée, on resservira la classique mais indémontrable « demande du public » ou son « droit à l’information ». Tantôt encore, on évoquera « le propre des sagas politiques » qui fonctionnent par « chapitres et rebondissements », à la manière de « vraies séries télévisées », avec « certains épisodes plus prenants que d’autres ». En somme, c’est l’existence de la mobilisation médiatique dans la durée et le recours, pour durer, au processus de la feuilletonnisation qui autoriseraient les médias à injecter de nouveaux « rebondissements » dans la « saga » alors même que les informations qui les alimentent ne sont pas sûres. Il est plus important d’entretenir la couverture médiatique, même artificiellement, que de diffuser des informations qui ne se dégonflent pas aussitôt publiées.
Si un tel estompement de la norme journalistique a pu se produire, c’est aussi qu’un présupposé s’est construit et a gagné l’ensemble des esprits à mesure que se sont multipliés les sujets « gouvernance » : les pratiques politiques locales seraient, par principe ou par essence, sujettes à caution, la démocratie représentative serait corrompue par les politiciens, les rémunérations publiques seraient indûment élevées, et la confiance citoyenne serait détruite par « toutes ces affaires » qui mettent en cause des élus ou des gouvernants cupides.
Bien que toxique, ce présupposé, sur le moment, s’est paré d’une telle force d’évidence qu’on n’en a pas ou plus aperçu « l’éléphant dans la pièce ». Certes, les malversations de Publifin, à côté d’autres scandales retentissants, en Belgique, en France ou en Europe, sont de nature à creuser, un peu plus, le fossé, la défiance abyssale de la population envers l’ensemble des institutions et, singulièrement, envers celles du pouvoir politique et particratique. Mais les « affaires » politiques, en sont-elles pour autant des éléments moteurs ?
DE PUISSANTES LAMES DE FOND
Et c’est ce dont traite, précisément, l’enquête « Noir, jaune, blues » présentée début 2017, vingt ans et quelque après sa première édition. Ses résultats et ses analyses amènent, pour expliquer la rupture du pacte de confiance, à mettre plutôt l’accent sur l’œuvre de puissantes lames de fond, taille éléphant, qui réduisent en miettes la « puissance d’agir » du politique. En tête de ces tendances lourdes qui traversent nos sociétés, on retrouve, sans surprise, l’hégémonie souvent cynique d’une sphère financière globale et non régulée, qui agit au seul service des intérêts du capitalisme actionnarial et patrimonial, et qui transforme les représentants démocratiques des peuples en obligés ou en fondés de pouvoir.
Chaque restructuration ou délocalisation d’une filiale belge de multinationale le montre : la logique dominante de la rentabilité financière à court terme confronte le monde politique régional ou national à sa propre impuissance – d’où la place phénoménale prise par l’ersatz qu’est la communication politique. Fondamentalement, ce que les manifestations de colère traduisent à l’égard du politique, c’est une critique – d’autant plus virulente qu’elle ne s’exprime pas toujours directement en ces termes – de l’incapacité des gouvernants à encore pouvoir « faire le métier », c’est-à-dire, faire de la politique, au sens plein du terme : gouverner la société en cherchant à rendre meilleurs la vie collective et les destins individuels, et non se voir réduit à flatter les intérêts privés pour s’attirer leurs faveurs ou leur bienveillance vis-à-vis de l’économie, des emplois et des comptes locaux ou nationaux.
Pris en étau par en haut, le pouvoir politique l’est aussi par le bas : la tendance de l’individu contemporain à « s’autonomiser », à s’affranchir des appartenances collectives, des identités héritées et des valeurs « ciments », en voie d’effritement, de la société constitue une autre source de la difficulté d’agir du politique. Pareille configuration sociétale nouvelle, explique le coordinateur de l’enquête Benoît Scheuer1, vient nourrir le sentiment ou la conscience que « la société n’existe plus », comme le soutient le sociologue Alain Touraine, et que « l’individu est seul », puisque la globalisation a, selon lui, détruit toutes les institutions collectives et la société elle-même2.
DES ACIDES CORROSIFS
La mutation est d’autant plus forte dans ses effets qu’un autre « acide », pointe Scheuer, vient corroder la carrosserie de la société : l’expansion vertigineuse, en dix ans, des médias sociaux et de leurs contenus aux effets déroutants. Les réseaux sociaux incarnent une donne nouvelle, tant pour les médias que pour les responsables politiques, les mouvements sociaux et les citoyens, notamment quant à la vitesse et à l’ampleur de la propagation des informations. Ce qui change aussi, par leur intermédiaire, ce sont les modes, désormais plus horizontaux, de réception, de perception et de hiérarchisation sociales des nouvelles d’actualité, via leur appropriation par les utilisateurs des réseaux sociaux.
De quoi renforcer encore le sentiment d’autonomie de l’individu au cœur de ces réseaux fondamentalement plus communautaires que sociaux. Mais, d’un autre côté, en présence de mécanismes d’intégration sociale qui ne fonctionnent plus ou à peine, et gagné par la peur du déclassement social, l’individu numérique se voit renvoyé à son isolement, aux dominations qu’il subit dans sa vie quotidienne, et, en fin de compte, à son statut de victime qui ne trouve plus à s’exprimer dans un mouvement de contestation de l’ordre socio-économique. Le repli identitaire est à portée demain…
Face à de tels défis, il ne suffit pas de remporter la bataille de la communication sur les « affaires ». Ni de se lancer dans une course de vitesse pour réformer la gouvernance locale et ses règles (sans même attendre les résultats et les recommandations de la commission d’enquête parlementaire Publifin, pourtant désignée à cette fin). Le corps social, déçu et en colère, n’en a que faire… même s’il lui arrive de s’en saisir, dans son désarroi général, comme d’un os à ronger. Ce n’est pas la transparence du poste de conduite qui doit être revue, mais la capacité à conduire le véhicule public au mieux de l’intérêt général qui doit être refondée.
- Intervention à l’IHECS, le 27 février 2017, devant un auditoire d’étudiants en 1er master de journalisme.
- Alain TOURAINE, La fin des sociétés, Seuil, 2013