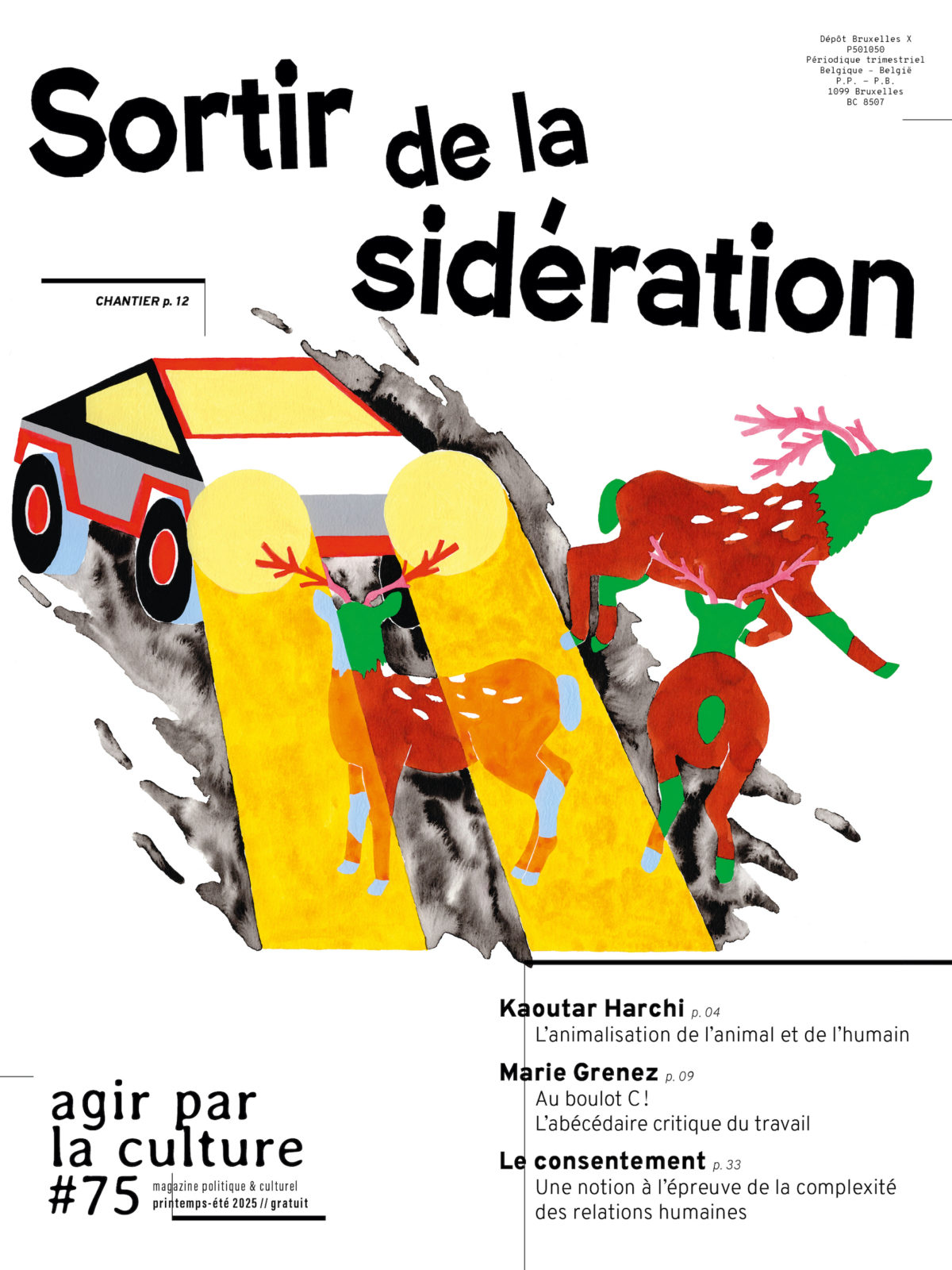D’où vient cette injonction à voyager, à partir le plus loin possible puisqu’une destination proche parait toujours moins bien, moins désirable qu’une destination lointaine ?
Avec Christophe Mincke, nous avons voulu montrer que nous vivions dans une société qui est en train de remettre en cause les frontières et où est sans cesse répétée l’idée d’un espace ouvert où il y a toujours une nouvelle opportunité dans le temps qui se présente et qu’il faut pouvoir saisir. Cette opportunité, c’est celle de découvrir de nouveaux espaces, d’être soi-même dans la découverte de la vie et du monde. En somme, l’idéal mobilitaire affirme : « Je dois pouvoir aller n’importe où, n’importe quand, quand ça se présente ».
Cette mobilité « kinétique », c’est-à-dire le fait de pouvoir changer tout le temps de projets, de pouvoir tout le temps rebondir sur une nouvelle chose qui se présente, nous éloigne des sécurités traditionnelles. Ainsi, on ne fait plus des vacances comme dans les années 1970 où on retournait chaque année au même camping, pour retrouver les mêmes personnes, dans un lieu qu’on connait déjà et dans lequel on a une part d’identité. Non, dans l’idéologie dominante actuelle, le type de voyage valorisé sera : pouvoir circuler, être au bon endroit au bon moment, là où se passent les choses. Et si ces choses sont loin, ce n’est pas grave. Et si l’espace où je suis ne va être différencié des autres que par quelques petites caractéristiques, par exemple si ma chambre d’hôtel va être la même partout dans le monde, tant pis. Pour peu qu’on soit au bon moment au bon endroit.
Toutes ces pressions à devoir saisir de nouvelles opportunités de déplacements sont comme redoublées par un jeu médiatique, par toutes les images que nous recevons continuellement sur des nouveaux coins du monde à découvrir, des nouveaux endroits où aller. Elles sont autant d’incitations nous disant : « Tu dois te réaliser ! », « Qu’est-ce que tu fais de ta vie ? », « Comment, tu n’as pas vu tel endroit ? ». En fait, aujourd’hui, les voyages ont en quelque sorte déjà été effectués sur vidéo, avant même qu’on y soit allés. Voyager ne devient qu’une sorte de concrétisation d’un imaginaire qu’on a déjà vécu, justement par l’image elle-même. Loin d’une découverte aventurière, il y a toute une incitation à aller simplement concrétiser des images. D’autant plus qu’on va à son retour (ou pendant le voyage lui-même sur les réseaux sociaux numériques) montrer la photo comme pour dire « j’y étais, je l’ai fait ».
Ces injonctions au voyage et à partir prennent donc place dans un système plus global où plus on est mobile, mieux c’est. Un système qui nous enjoint constamment à la mobilité généralisée, à changer de boulot, de logement, de partenaires, d’opérateur pour trouver le meilleur prix…
Ce n’est en effet qu’un épiphénomène d’une logique globale suivant laquelle il n’est plus possible de s’ancrer : rester au même endroit, ce n’est aujourd’hui plus valide. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la réaction des gens lorsqu’on leur dit qu’on ne part pas en vacances : on attirera probablement un regard un peu attristé et des remarques de type « ah mon pauvre vieux… ». Et ce, même si on affirme avoir des activités intéressantes prévues ici…
Ces idées de pouvoir aller partout, d’avoir envie d’aller partout, de construire soi-même son voyage en fonction des opportunités qui se présentent, de porter soi-même sa mobilité correspondent très bien à l’idéologie d’aujourd’hui. C’est-à-dire aux discours suivant lesquels nous devrions absolument avoir une activité, mais où nous devons en plus nous activer et faire nos choix nous-mêmes, donner un sens à ce qu’on fait, être toujours dans des projets. Et pouvoir évidemment rebondir sur de nouveaux projets qui se présenteraient dans le temps.
Car même en vacances, on est sommés d’être actifs. Les vacances ne peuvent plus être le moment où on se dit « je m’arrête », sinon elles ne seront pas réussies. Donc, le voyage, c’est la première réponse à cette injonction à la mobilité, mais ça ne suffit pas. Si on dit qu’on est tout le temps resté sur la plage, on nous dira qu’on est passé à côté de son voyage. Il y a donc toute une pression non seulement à être actif (à participer à une série d’activités) mais aussi à l’activation (à être la source de sa propre activité). Et tout ça fait partie d’un même esprit idéologique.
C’est né avec le néolibéralisme ?
Si le néolibéralisme a beaucoup d’accointances avec ce modèle-là, c’est avant tout fortement lié à l’individualisation, un processus suivant lequel l’individu veut de moins en moins que le groupe lui assigne une place prédéfinie et veut de plus en plus trouver lui-même la place qu’il va prendre, en fonction de ses propres ressources. Évidemment, le néolibéralisme a surfé sur ce processus pour dire : « OK, trouve ton travail ! Et si tu n’en trouves pas, c’est que tu ne t’es pas assez activé pour ».
Plus formellement, le modèle du marché économique est lui-même un modèle d’étendue spatiale où les frontières ne sont pas les bienvenues : je dois pouvoir commercer avec n’importe qui sans entrave. Le modèle de l’économie libérale renvoie également, comme Marx l’avait déjà fait remarquer, au projet de récupérer le plus rapidement possible le capital investi, pour mieux le réinvestir ailleurs. L’espace ouvert et le flux constant de capitaux correspondent donc parfaitement au modèle spatiotemporel valorisé aujourd’hui dans la société sans répit.
Est-ce que cet idéal mobilitaire a tendance à servir les classes plus aisées, mieux dotées pour « saisir les opportunités », au détriment des classes populaires ?
Il y a en tout cas toute une question de rayonnement social lié à la mobilité lointaine. Quel est encore le sens, à l’heure de la vidéoconférence, de faire des réunions internationales qui demandent à tous les participants de se déplacer en avion ? Si c’est resté une pratique très fréquente, c’est avant tout parce qu’elle confère du prestige aux individus qui la pratiquent et qui évoluent souvent dans les classes aisées (hommes et femme d’affaires, universitaires, etc.). Car plus on bouge, plus c’est prestigieux.
Si vous dites « moi, j’aime rester dans mon pays », le regard va directement être suspicieux : « Tiens, est-ce que c’est un nationaliste ? Est-ce que c’est quelqu’un qui n’est pas ouvert au monde ? » Or, bien sûr, ce n’est pas parce que vous ne bougez pas que vous n’avez pas un cosmopolitisme relationnel, c’est-à-dire une ouverture aux autres cultures, un intérêt pour ce qui se passe ailleurs, etc. Et ce n’est pas parce que vous bougez que vous avez nécessairement cette ouverture. Prenons l’exemple caricatural de touristes qui ne sortent pas de leur Club Med mais qui affirmeront quand même « je suis allé au Sénégal » alors qu’ils n’ont rien vu du pays. Ce n’est pas parce que le voyage est effectué que nécessairement l’ouverture au monde est présente. Mais malgré tout, on valorisera celui qui a voyagé. Prenons aussi l’exemple de l’étudiant Erasmus qui aura paressé sur la plage à Barcelone mais qui sera pourtant mieux vu et valorisé que celui qui sera resté étudier laborieusement en Belgique. C’est comme s’il fallait nécessairement être mouvant pour être quelqu’un de bien. Il y a une idéologie qui va dire : « Ah, voilà quelqu’un qui voyage, qui découvre, qui est ouvert au monde ! » Peut-être qu’aujourd’hui, cette représentation commence à être battue en brèche pour des questions écologiques et se reconfigurera à l’avenir.
Comme toute idéologie, non seulement, on est enjoint de faire quelque chose, ici de se bouger, de s’activer, de chercher le changement pour lui-même, mais en plus, on est aussi prié d’aimer ça et de l’affirmer. Comment cela se manifeste-t-il ?
Dans cette idéologie mobilitaire, on vous demande de vous activer, mais on ne va pas vous dire quoi et comment faire. Car c’est également à vous de trouver le moyen de rentrer dans ce système en lui donnant du sens, en élaborant un plan de manière autonome. La mobilité doit devenir quelque chose qu’on estime positif parce que sinon on remet en question cette injonction à l’ouverture, à sortir des sentiers battus, à devoir par exemple partir et réussir ses vacances par l’activité. Parce que sinon vous ne participez pas au monde qui est proposé, vous ne cherchez pas votre propre développement personnel et vous êtes donc considéré comme un loser ! Ou stigmatisé comme inactifs.
C’est la même chose avec les injonctions données aux chômeurs. Il ne suffit pas de se dire qu’on est au chômage, c’est-à-dire un travailleur privé d’emploi, et recevoir son allocation ». Non, on est prié de s’activer, c’est-à-dire qu’on doit prouver qu’on cherche un emploi et ce, même si on sait qu’on n’a aucune chance d’en trouver ! Si on peut le prouver, on recevra son allocation, sinon ce sera la preuve qu’on ne veut pas se réaliser soi-même. Parce que la seule réalisation possible, c’est en cherchant du travail, en restant « En Marche ». Il faut rester dans la fiction que la société n’y est pour rien…
Dans le modèle idéal-typique en vigueur dans les années 60, je vise dans mes études à atteindre un statut social que j’espérais garder toute ma vie. Avec peut-être des possibilités de passer des concours ou de recevoir des promotions (des « mobilités de franchissement ») pour monter les échelons de la pyramide. Globalement, les choses sont stables et mon statut m’est donné par la société.
Mais aujourd’hui, la routine est devenue quelque chose d’infréquentable. Ça devient difficile d’affirmer « je suis bien là où je suis ». S’installer, s’établir, accepter la routine, c’est perçu comme quelque chose qui va nous détruire : non, il faut se bouger, changer, entreprendre ! C’est à moi de montrer tout le temps qui je suis. J’ai une position professionnelle, mais qui sait si mon poste existera encore dans 5 ans ? Si par malheur mon emploi est remis en question, ma qualité sera de me reconstituer dans mon identité sur autre chose. Or, tenir ce discours n’est pas si facile que ça. Car en réalité, on a besoin de routine pour faire un bon boulot. Et puis, chacun investit énormément dans son parcours professionnel, il y a quelque chose d’identitaire profond pour soi qui est lié à son travail et se reconstruire n’est pas sans coût.
Justement, que masquent ces injonctions ? Des rapports sociaux de domination ? Des souffrances sociales ?
Nous sommes dans une société qui vous enjoint à « monter des projets », avec une équipe puis une autre, etc. Mais à côté de ces circulations en flux où les travailleurs passent de projet en projet, d’équipe en équipe, nous avons aussi toujours des structures pyramidales héritées de la société de l’ancrage.
Or, on constatera que cela peut être très avantageux de tenir ce type de discours mobilitaire lorsqu’on est tout en haut de la pyramide… C’est-à-dire précisément là où on va pouvoir facilement développer toute une série de projets et se mouvoir socialement ‑on va même parfois venir vous chercher parce que votre profil est intéressant- tout en ayant l’assurance du statut d’être en haut. Bref, c’est très aisé de vivre la mobilité quand on a toutes les stabilités de la pyramide… Et d’appeler tout le monde à plus de souplesse, de flexibilité, d’agilité quand sa position à soi n’est pas remise en question. Cela permet à un dominant d’être celui qui respecte le mieux les impératifs mobilitaires (l’activité, l’activation, la participation et l’adaptation), ce qui maintient sa domination en légitimant sa place tout en haut de la pyramide et l’exclusion de ceux qui sont à la traine. Le plus fort dans le jeu de mobilité, c’est celui qui peut non seulement faire bouger l’autre, mais qui peut aussi choisir ses mobilités.
D’autant que dans notre société, on va toujours nier le coût de cette mobilité — que l’individu doit porter seul. C’est-à-dire d’un processus qui va nous faire courir partout et tout le temps, au risque de l’épuisement. On devrait donc toujours se poser la question de savoir si ce coût de mobilité ramène vraiment une plus-value suffisante ou pas.
À propos de coût, est-ce qu’une société qui place comme valeur cardinale cette hypermobilité peut devenir écologique ?
Il y a l’idée ancienne de liberté derrière toute cette mobilité, celle qui vous permet d’aller où vous voulez, quand vous voulez. On se souvient par exemple du slogan « ma voiture, c’est ma liberté ». Mais lorsque la mobilité devient une injonction, une obligation à bouger, ça devient complètement paradoxal. Et puis surtout, comment contrôler les coûts liés à cette mobilité physique généralisée ? Comment continuer à dire qu’il faut (se) bouger et prôner en même temps une réduction de la mobilité physique en raison de son coût écologique ?
Et puis, comment faire vivre nos espaces locaux aujourd’hui ? On entend beaucoup de plaintes sur les coûts écologiques de la mobilité mais personne n’a réagi, ou si peu, quand la poste a supprimé de nombreuses boites aux lettres en Wallonie. Ou quand on a supprimé les écoles de village pour les déplacer dans les centres urbains. Dans une logique économique capitaliste, depuis les années 80, on a ainsi concentré tous les services, obligeant à des trajets supplémentaires et motorisés pour déposer son courrier ou ses enfants, faire ses courses… Ce qui d’ailleurs provoque plus d’embouteillages car il nous faut tous aller au même moment, à la même heure et au même endroit. Il y a tout un enjeu écologique à une décentralisation et à une déconcentration…
En plus de ce phénomène de concentration, les services locaux tendent aussi à disparaitre en raison d’une logique de vitesse par le transport individualisé qui fait que les espaces locaux finalement ne sont plus que des lieux de point à point. Il y a quelques années, j’avais imaginé pour le Conseil central de l’économie un scénario de sociologie-fiction provocant afin d’alimenter leur réflexion. Ainsi, si vous mettiez un limiteur de vitesse à 50 km/h sur toutes les voitures, vous n’interdirez pas la mobilité : tout le monde pourra continuer à se déplacer. Sauf que les transports en commun deviendront plus performants car vous irez plus vite en transport en commun qu’en voiture. Et puisque cela deviendra couteux de se déplacer, même pour aller à 10 km, on peut aussi imaginer un redéploiement local des services et commerces de proximité.
Que faire pour sortir de cette guerre de vitesse et des distances qui comme vous le dites, « handicape bon nombre de catégories sociales et fatigue les autres » ? Existe-t-il des alternatives à l’idéologie mobilitaire ? Faut-il réapprendre les vertus de l’immobilité ?
Je crois que nous devons trouver moyen de revaloriser le local tout en ne niant pas le global dans ce local (c’est toute l’idée déjà énoncée de « glocal »). Mais aussi de trouver les moyens de ralentir : comment mettre du temps dans les espaces ? Au niveau urbanistique, est-ce qu’on crée des réseaux qui permettent d’aller vite d’un point à l’autre mais où il n’y a plus de lieux parce que tout le monde est en mouvement constant ? Ou bien est-ce qu’on crée des lieux où il y a des franchissements, des espaces lents où on est obligé de prendre du temps pour faire les choses mais où on va rencontrer des gens, et où on va avoir une vie plus ancrée ? Ce qui ne veut pas dire qu’elle est déconnectée. Quel équilibre trouver entre ce qui serait de l’ordre du réticulaire de la vitesse et ce qui relève des espaces locaux qui gardent du sens, des lieux. C’est à repenser complètement.
Le problème, c’est que les réponses qu’on voit naitre sont des réponses d’extrême droite nationaliste avec des tentatives de recréer des frontières, des États-nations, où il y aurait des nous identifiés et supposément identiques identitairement. Non, il faut plutôt voir comment parvenir à redonner du sens à des espaces qui vont bouger lentement, mais qui sont bien connectés pour qu’on puisse aussi avoir des activités externes. Comment est-ce qu’on assure ces connexions pour qu’elles soient les moins coûteuses écologiquement ? Est-ce que c’est des livreurs qui doivent passer chez tout le monde ? Ou est-ce que chacun doit se déplacer pour aller chercher son colis ? Comment redensifier les villes, étendre et renforcer l’offre en transports en commun fiables, sûrs, et fréquents ? Il y a des choix politiques de long terme à réaliser et je pense que nous ne réduirons pas nos contradictions sans changer de modèle économique : on ne trouvera pas en interne les solutions pour réduire les problèmes qu’il cause, que ce soit en termes de dérèglement climatique ou de mobilité.
Bertrand Montulet & Christophe Mincke, La société sans répit - La mobilité comme injonction, Éditions de la Sorbonne, 2019.